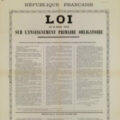Lu dans le Rapport de la mission effectuée par les deux Inspections Générales de l’Education Nationale (IGEN, IGAENR) sur « l’autonomie des établissements scolaires ».
« L’autonomie des établissements scolaires, couplée à une évaluation des établissements, est une pratique de nombreux pays de l’OCDE » exposent les 2 Inspections Générales en précisant : « L’autonomie peut se définir comme le transfert de responsabilité de l’État vers les établissements. Elle est à la fois la capacité pour un établissement public de disposer d’organes délibérants, d’un budget propre et de pouvoirs de décision dans des domaines définis et l’attribution de marges de libertés ».
Elles rappellent que « l’autonomie s’applique à la politique pédagogique et éducative au travers de l’adoption du projet d’établissement, du contrat d’objectifs, du règlement intérieur… ».
Les Inspections générales rapportent les « craintes » constatées.
- La crainte d’une menace d’une rupture d’égalité entre établissements.
La mission pilotée par les Inspections générales a pu « constater le fort attachement du corps enseignant à un système public d’éducation dont le caractère national a vocation à s’exprimer notamment dans un cadre normé uniforme garant de l’égalité de traitement entre établissements et entre élève ». Elle ajoute : « Aller dans le sens de l’autonomie se traduirait nécessairement par la mise en concurrence des établissements sur « un marché de l’éducation ».
Le manque de moyens alimente aussi la méfiance quant à la capacité des collectivités territoriales concernées de financer correctement ce que l’État leur transfère. « Attachés à un cadrage national, ils revendiquent avant tout des orientations précises (programmes et horaires d’enseignement) et non des arbitrages rendus au niveau local » (ou territorial).
- La crainte de rivalités ou tensions entre disciplines.
L’identité professionnelle des enseignants est construite en référence aux disciplines et leurs pratiques au sein de la classe. La mission a constaté la crainte que « l’autonomie génère des conflits quant à la répartition des moyens et des horaires selon un principe bien connu « déshabiller Pierre pour habiller Paul » ».
« C’est en raison de ce conflit que les enseignants sont, dans leur majorité, favorables à une répartition entre les disciplines la plus cadrée possible par des textes réglementaires ».
N’est-il pas vrai que les horaires à géométries variables n’ont que des inconvénients, sauf évidemment, si on abolit les exigences de programmes scolaires annuels (avec une progression) pour tous les élèves d’une même classe ! Dans ce cas les projets locaux de toute nature l’emportent sur les programmes scolaires. Les élèves seront certainement épanouis mais souvent ignorants.
Comme le rapporte la mission, selon la formule d’un enseignant : « plus on a d’autonomie, moins il y a de cohésion. »
- La crainte d’un pouvoir excessif donné au chef d’établissement.
La mission souligne que « les enseignants sont extrêmement soucieux que l’autonomie ne soit pas un prétexte pour octroyer au chef d’établissement un pouvoir supplémentaire non seulement sur leurs conditions d’exercice mais aussi sur leurs pratiques de classe alors qu’ils ne lui reconnaissent pas de légitimité en ce domaine. »
- La crainte d’une menace à la liberté pédagogique.
Si « l’obligation de respect des programmes et l’action des corps d’inspection sont globalement bien acceptées », la mission constate que « la revendication de la liberté pédagogique va de pair avec l’affirmation du cadre national, en particulier des programmes et s’oppose à la limitation de la liberté de l’enseignant par des objectifs collectifs et locaux pris au nom et dans le cadre d’un fonctionnement autonome de l’établissement ».
Qui pourrait contester la validité de cette évidente affirmation ?
La mission elle-même rapporte d’ailleurs que, sur ce point, elle a entendu que « l’adhésion au projet d’établissement dans l’enseignement privé sous contrat constitue l’un des préalables au recrutement et que le travail collectif s’en trouve facilité ». Faut-il commenter cette référence à l‘organisation de l’enseignement privé ?
- Une autonomie financière très limitée.
Les budgets des établissements scolaires sont composés de fonds publics et de dépenses obligatoires. Les collectivités territoriales en reprennent d’ailleurs souvent une bonne partie en régie directe. Donner aux établissements la responsabilité d’aller chercher des fonds privés (droits d’inscription, sponsorisation ou charité publique) serait immédiatement compris comme un processus de privatisation.
Reste-t-il encore un doute quant au démantèlement de l’Éducation Nationale, en partie engagée, que représenterait la mise en place de « l’autonomie des établissements scolaires » en leur imposant « un projet éducatif territorial » ?
Ce serait certes un établissement dit scolaire, mais ce ne serait plus l’Éducation Nationale dont l’État et son Ministère n’auraient plus la pleine et entière responsabilité.