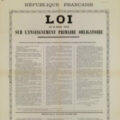Ce livre n’est pas assez connu, même s’il date de 1996, et portant il fait œuvre utile. Il est un excellent complément, avec un autre éclairage, à notre numéro de notre Collection Arguments « Langues régionales : la Libre Pensée ouvre le débat » qui réinvestit le débat sur cette question.
Selon la vulgate régionaliste et/ou réactionnaire, la IIIe République, en fondant l’Ecole, aurait voulu éradiquer les « racines » des territoires et liquider les patois et les dialectes locaux. Cet ouvrage fait tabula rasa de ces affirmations mensongères. Jamais la République n’a voulu déraciner les élèves et les maîtres. C’est l’Abbé Grégoire qui avait une obsession des « patois » et qui voulait les éliminer, pas la République.
Preuves à l’appui, Jean-François Chanet le démontre. Par exemple, si le modèle républicain est le département (œuvre de la Révolution française, sur le principe « diviser pour unir ») et non la commune qui rappelait un peu trop la paroisse, l’État républicain a tenu le plus grand compte des particularités locales. Le recrutement des enseignants se faisait dans le cadre départemental et non nationalement, ce qui aurait nivelé les terroirs. Au contraire, il y avait une volonté profonde de ne pas déraciner les maitres, c’est pourquoi la République s’est attachée à créer les Écoles normales par département, et non dans une École centrale à recrutement national.
De même l’incitation de faire faire des travaux dirigés dans les classes avec la découverte de la géographie et de la nature, de manière théorique et physique, en faisant visiter les campagnes par les élèves pour leur expliquer les diversités dans un cadre national, aurait été incompatible avec une volonté d’éradiquer les particularités locales. Le grand succès jamais démenti d’ouvrages populaires comme « Le Tour de France par deux enfants » montraient clairement l’intérêt et l’attachement à la ruralité et à la diversité des régions de France, de même que le Syndicat National des Instituteurs et son « Tour de France en 40 récits ».
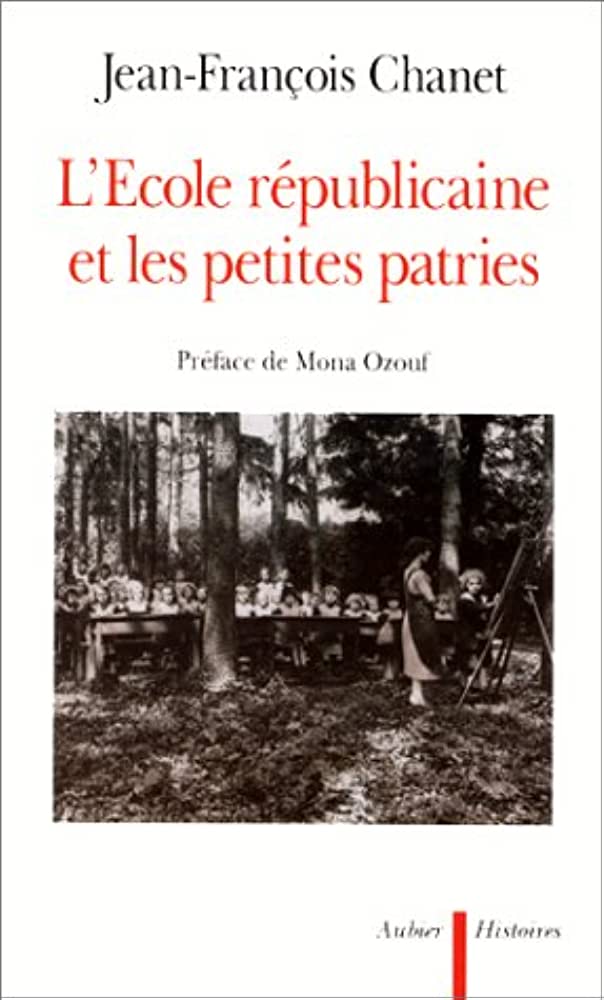
Plus tard Jean Zay fera aussi beaucoup pour développer l’engouement pour le folklore. Il écrira : « Apprendre à regarder le pays natal, ce n’est pas seulement s’y attacher davantage, c’est y puiser des outils intellectuels pour élargir son horizon et gagner en liberté comme en compréhension du monde ». Et c’était bien avant Vichy qui n’hésita pas à le faire assassiner par la Milice.
Bien au contraire, il y a eu de la part de beaucoup de Ministres de l’Instruction publique (sauf Emile Combes, mais cela n’étonnera pas ceux qui connaissent sa conception quelle que peu autoritaire de la Laïcité, il était même pour interdire les dialectes locaux dans le Catéchisme. En quoi cela le regardait-il ?) Cependant il fit une circulaire le 15 mars 1896 pour récompenser les instituteurs qui participaient aux travaux archéologiques et historiques. Mais cela n’allait pas plus loin, une volonté souvent manifestée d’intéresser les Maîtres pour intéresser les élèves au folklore local par le biais d’une aide financière pour les aider à cotiser aux Sociétés d’histoire locale. Le grand Historien Marc Bloch, si chaud au cœur de beaucoup d’entre nous, allait totalement dans le même sens, de même que l’Ecole libératrice et l’Ecole Emancipée revues syndicalistes. Et ne parlons pas du Centre laïque des Auberges de Jeunesse dont c’était la base même. Terminons par rappeler le profond attachement de Jean Jaurès aux parlers locaux. Qui mettrait en doute son caractère républicain et laïque ?
La légende veut aussi que « le retour à la terre qui ne ment pas » du Régime de Vichy était de faire respecter les terroirs. Bien au contraire, respecter les terroirs passait d‘abord par expliquer les terroirs dans le rapport aux autres. Si Pétain encouragea « l’attachement à la terre », c’était pour mieux faire ressurgir chez les paysans l’obéissance « naturelle » qu’ils avaient toujours eu en tant que serfs à leur seigneur. Ce n’était en aucun cas pour leur ouvrir l’esprit comme voulait le faire la République, c’est bien pourquoi il supprima derechef les travaux dirigés qui expliquaient le monde dans lequel se mouvaient les élèves. Il fallait en faire des sujets obéissants et non des esprits libres. Comme le note Jean-François Chanet : « L’activité dirigée allait plus loin que la promenade scolaire ou la classe-promenade. Le loisir y était plus que jamais considéré comme le complément naturel d’un savoir dont la maitrise aiderait l’homme à se libérer des idées reçues, à se défier des idéologies totalitaires. »
Il faut prendre et comprendre la République dans le contexte de l’époque, elle mettait le ruralisme et le localisme à l’honneur dans un École qui vantait l’unité de la Patrie. Il fallait attacher les élèves à leurs sols pour mieux les projeter pour la gloire de la Patrie. Le raisonnement était clair : plus les élèves, futurs soldats, seraient attachés à leur glaise, plus ils seront d‘excellents soldats pour défendre le sol natal et national. On peut penser ce que l’on veut aujourd’hui de cela, et personnellement je ne me reconnais nullement dans cette problématique guerrière et revancharde, mais cela prouve qu’il n’y avait pas une volonté d’éradiquer les particularités locales, notamment les dialectes et patois. Ferdinand Buisson dira même : « L’amour de la petite patrie mène à l’amour de la grande ».
L’auteur montre aussi les expériences pédagogiques pour enseigner les patois dans l’École publique comme un exercice pour mieux comprendre le français. Il note d’ailleurs, par exemple, que la langue d’Oc était souvent plus riche pour faire comprendre quelques règles et mots de Français. Il y avait d’ailleurs des régions entières où les élèves entrant à l’École laïque ne parlaient que leur patois ; si les maîtres n’en avaient pas eu une pratique réelle et certaine comment auraient-ils enseigné ? Si les maîtres avaient fait autrement, l’École publique n’aurait jamais pu s’enraciner durablement dans les campagnes, elle aurait été rejetée comme un produit d’exportation. Or, c’est tout le contraire qui a eu lieu. Michel Bréal, grand pédagogue et linguiste de renommée dans l’Éducation nationale ne disait-il pas : « Rien n’est plus fâcheux et plus erroné que cette manière de traiter les dialectes. Loin de nuire à l’étude du Français, le patois en est le plus utile auxiliaire » ?
La multiplication des activités péri, para et postscolaires ne pouvaient se faire sans être accrochées à des goûts, us et coutumes et pratiques locales. La multiplication de la construction des écoles, outre que cela favorisait l’économie locale, conduisait à une guerre des monuments entre l’École laïque et l’Église. Cela n’aurait pu être tolérée, à cette époque, par les populations si cela avait été basée sur une éradication du « localisme« . L’auteur cite de nombreux sujets d’examens et de concours à travers le temps qui valorisent l’aspect local.
Le recrutement local des institutrices et des instituteurs a toujours été tenu pour préférable que la mutation hors du département. D’ailleurs, n’est-ce pas là une des raisons de la loi Roustan de rapprochement des conjoints, permettre le retour à son point d’origine ? Cette loi était faite notamment pour fixer le « cheptel » des enseignants dans le département, unité principale de la République. Cela s’opposait à l’uniformisation nationale faussement appelée « jacobine », c’était la marque du respect des cultures et coutumes locales. Il n’y a pas eu de constitution plus centralisée que celle des Girondins-Thermidoriens de 1795.
L’auteur poursuit aussi son étude sur les langues régionales et note avec raison que la loi Deixonne du 11 janvier 1951, première loi française autorisant l’enseignement des langues régionales de France n’aurait eu aucune raison d‘être, si les langues régionales, dialectes locaux et patois avaient totalement disparu. Cela pourrait sembler étonnant à la vue du positionnement de certains aujourd’hui (les écoles Diwan ont toujours été soutenues par les cléricaux en Bretagne), mais qui a imposé la langue française en immersion et interdit les parlers locaux ? : les Frères des écoles chrétiennes. Certains avaient voulu interdire, mais sans succès, l’emploi de la langue allemande dans les départements retrouvés d’Alsace-Moselle. C’était matériellement impossible de le faire dans l’École.
Il y a aussi beaucoup de passages du livre fort intéressants sur la notion du Primaire qui était une fierté des Institutrices et des Instituteurs, à une époque où le Certificat d’études primaires était un « aimant social » pour tous. Je recommande vraiment la lecture de cet ouvrage qui vous apportera beaucoup et qui réduit à néant les fadaises et billevesées sur l’École publique et Laïque, « niveleuse des différences ». Il fallait faire ce livre et Jean-François Chanet l’a fait. Qu’il en soit vivement remercié.
Christian Eyschen
L’École républicaine et les petites patries par Jean-François Chanet –Editions Aubier-Histoire- 428 pages – 35,21€