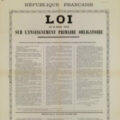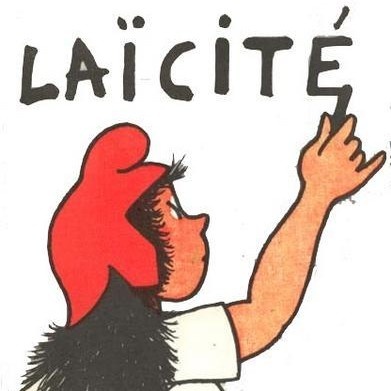Alors que les institutions de la Cinquième République montrent des signes évidents d’agonie depuis la réélection du président de la République en mai 2022, entré par effraction sur la scène politique en 2017 à la faveur de l’effondrement des partis traditionnels ayant soutenu le régime de pouvoir personnel en place depuis 1958, d’aucuns proposent à nouveau d’inscrire dans la Constitution du 4 octobre 1958 les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Cette proposition entend ainsi sanctuariser la liberté de conscience, celle de culte et le principe selon lequel l’État « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Il s’agit en réalité d’une fausse bonne idée. De surcroît, les expériences récentes invitent à la plus grande prudence en la matière.
Une perspective sans véritable objet
La proposition de constitutionnalisation des deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 méconnaît à la fois la jurisprudence du Conseil constitutionnel et la pratique du juge administratif.
La liberté de conscience figure d’ores et déjà dans le bloc de constitutionnalité. Dans sa décision du 23 novembre 1977((C, 23 novembre 1977, n° 77-87 DC.)), le Conseil constitutionnel l’a érigée en principe fondamental reconnu par les lois de la République au regard de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ; que le Préambule de la Constitution de 1946 rappelle que « Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » ; que la liberté de conscience doit donc être regardée comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; »
Lorsque le juge administratif se prononce, de son côté, sur la légalité d’actes susceptibles de porter atteinte à la loi du 9 décembre 1905, comme en matière de présence d’emblèmes religieux sur des emplacements publics, il établit une étroite imbrication entre l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, repris de celle du 27 octobre 1946, et les dispositions du texte de 1905. Ainsi, à propos de l’illégalité de l’installation de crèches de Noël dans les locaux abritant le siège d’une collectivité territoriale, le Conseil d’État motive ses décisions d’annulation en considérant notamment ce qui suit : « Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : » La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. « . La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun.
Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 [a] pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes [en interdisant] l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse.» Pour le Conseil, les articles 1ers de la Constitution et 1 et 2 de la loi de 1905 forment donc en quelque sorte un tout indissociable.
Le précédent de la constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse et la frilosité du Conseil constitutionnel
En second lieu, la constitutionnalisation nouvelle de la liberté d’avorter devrait susciter la réflexion chez ceux qui veulent emprunter la même voie en matière de séparation des Églises et de l’État. De même, deux décisions récentes du Conseil constitutionnel devraient les conduire à tempérer leurs ardeurs.
Alors qu’aucune menace juridique sérieuse ne pesait sur la législation en vigueur en cette matière, la loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) devrait faire réfléchir ceux qui entendent introduire les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 dans la Constitution du 4 octobre 1958. Elle a créé un quatrième alinéa à l’article 34 déterminant le champ de compétence du pouvoir législatif ainsi rédigé : « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »
Elle donne au législateur le pouvoir d’encadrer la liberté de recourir à l’avortement sans garantir un droit effectif. Désormais, en théorie, le Parlement pourrait même déterminer des conditions d’exercice de la liberté d’avorter plus strictes que celles actuellement prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du Code de la santé publique. En la matière, le véritable enjeu réside davantage dans les moyens dévolus à la pratique de l’IVG dans les établissements de santé que dans l’introduction d’un nouvel alinéa dans l’article 34 : or, ils ont sérieusement diminué. Bref, cette loi constitutionnelle, très largement votée, constitue une illusion sur le plan juridique.
Par ailleurs, imaginons que François Hollande, en application de la proposition 46 de son programme, ait réussi à faire introduire in extenso les articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 dans la Constitution du 4 octobre 1958dans la foulée de son élection de mai 2012, moyennant par exemple la création d’un article 1 bis ou 1-1. Il est probable que le Conseil constitutionnel aurait pris les mêmes décisions que celles qu’il a rendues les 21 février 2013 et 22 juillet 2022.
L’expérience du Statut d’exception clérical d’Alsace-Moselle
Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité en 2012 tendant à lui demander de déclarer contraires à la Constitution du 4 octobre 1958 « […] l’article VII des articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes » applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’institution de la rue Montpensier, se fondant sur les articles 10 de la Déclaration du 26 août 1789 et 1er de la Constitution, a rappelé « que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit; qu’il en résulte la neutralité de l’État ; qu’il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte ; ».
Pour autant, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article VII des articles organiques du culte protestants applicables dans les trois départements de l’Est de la France au seul motif « qu’il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1er que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu’en proclamant que la France est une « République. . . laïque », la Constitution n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte »((CC, 21 février 2013, n° 2012-297 QPC.)). L’introduction des articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 en 2012 n’aurait rien changé à cette motivation, d’ailleurs très fragile, fondée sur l’absence de travaux sur ce point de la part des auteurs des Constitutions de 1946 et 1958.
De même, dans une décision du 22 juillet 2022 répondant à une QPC, au regard des termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, le Conseil constitutionnel a jugé que l’introduction d’une procédure de reconnaissance des associations cultuelles à la main des préfets, décrite au nouvel article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 issu de celle du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, n’est pas contraire aux principes fondamentaux de la laïcité de la République, bien qu’elle constitue manifestement une entorse très grave à l’article 2 du texte fondateur de la séparation et de la laïcité en France : « […] les dispositions contestées [celles de l’article 19-1] ont pour seul objet d’instituer une obligation déclarative en vue de permettre au représentant de l’État de s’assurer que les associations sont éligibles aux avantages propres aux associations cultuelles. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’emporter la reconnaissance d’un culte par la République ou de faire obstacle au libre exercice du culte, dans le cadre d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles. »
Ce raisonnement bancal – la vérification préalable du caractère cultuel d’une association ne serait pas une forme de reconnaissance d’un culte ni contraire au principe fondamental de la liberté de conscience – aurait été sans aucun doute le même dans l’hypothèse où les articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905 auraient figuré dans le texte de la Constitution du 4 octobre 1958 depuis 2012 : au lieu de se fonder sur l’article 10 de la Déclaration du 26 août 1789, il se serait appuyé sur virtuel 1 bis ou 1-1 issu de la loi de 1905.
Notons que ceux qui réclament à cor et à cri la sanctuarisation des deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 n’ont pas bougé le petit doigt pour contester sa révision assez profonde intervenue en août 2021, à la faveur du vote de la loi dite « séparatisme ». Au contraire, ils ont soutenu sans barguigner le gouvernement. Il y a l’esbroufe, il y a l’action. La Libre Pensée est du côté de l’action et dénonce l’esbroufe qui sert de rideau de fumée.
La Fédération Nationale de la Libre Pensée